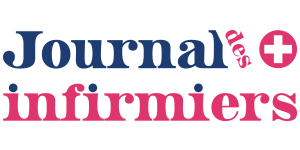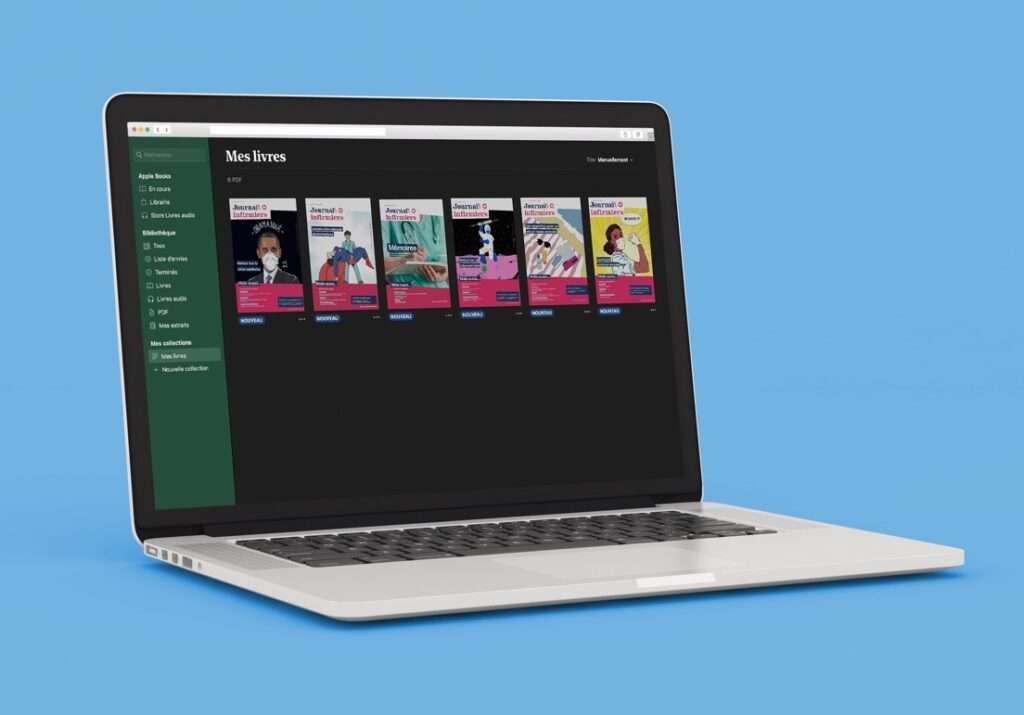Les plaies chroniques touchent une part croissante de patients à domicile, en EHPAD et à l’hôpital. Douleur, risque infectieux, retentissement fonctionnel : l’enjeu est majeur pour la qualité de vie et la sécurité des soins. Ce guide propose une démarche claire et reproductible pour reconnaître, évaluer et traiter les plaies chroniques (escarres, ulcères veineux/mixtes/artériels, pied diabétique), en s’appuyant sur la méthode TIME et les bonnes pratiques infirmières.
Comprendre les plaies chroniques et leurs impacts
Les plaies chroniques sont des plaies qui n’évoluent pas vers la cicatrisation en 4 à 6 semaines. Les étiologies principales sont :
- Escarres liées aux pressions prolongées et au cisaillement ;
- Ulcères veineux (souvent malleolaires), parfois mixtes veino-artériels ;
- Ulcères artériels (ischémiques), plus douloureux et distaux ;
- Pied diabétique (neuropathique, ischémique ou mixte), à haut risque d’infection et d’amputation.
Les conséquences pour le patient incluent douleur, odeur, exsudat, isolement social, perte d’autonomie. Pour l’équipe soignante : temps de soins élevé, risques d’infection, nécessité d’une coordination pluridisciplinaire. L’objectif est double : cicatriser quand c’est possible et réduire le fardeau (douleur, macération, infections, récidives).
Évaluer efficacement : la méthode TIME et le bilan étiologique
Analyser le lit de la plaie avec TIME
- T – Tissue (tissus) : identifier nécrose, fibrine, bourgeon, épithélialisation. Priorité : préparer le lit pour favoriser un tissu de granulation sain.
- I – Infection/Inflammation : repérer rougeur, chaleur, douleur, œdème, odeur, tissu terne, stagnation. Attention au biofilm (plaie qui stagne malgré pansements adaptés).
- M – Moisture (humidité) : ajuster l’humidité pour éviter macération ou dessèchement ; gérer l’exsudat.
- E – Edge (berges) : surveiller berges décollées, hyperkératoses, macération ; protéger la peau périlésionnelle.
Bilan étiologique : orienter la stratégie
- Veineux / mixte : œdèmes, dermite ocre, varicosités. Vérifier l’IPS/ITB avant compression forte.
- Artériel : douleur au décubitus, peau froide/pâle, pouls périphériques diminués ; urgence médicale si ischémie critique.
- Pied diabétique : neuropathie (test au monofilament), déformation, hyperkératose d’appui ; évaluer chaussage et points de pression.
Évaluer douleur et exsudat
Utiliser une échelle simple (EVA/NRS) et décrire la qualité/quantité d’exsudat (séreux, purulent), l’odeur et l’impact sur les pansements. Adapter l’analgésie avant tout geste de détersion.
Facteurs généraux qui retardent la cicatrisation
Dénutrition, déséquilibre glycémique, tabac, traitements (corticoïdes, anticoagulants), anémie, hydratation insuffisante. Une prise en charge globale (médicale/diététique) accélère la cicatrisation autant que le choix du pansement.
Traiter avec méthode : détersion, pansements, compression et décharge
Préparer le lit : détersion sécurisée
Objectif : retirer nécroses et fibrines pour relancer la cicatrisation.
- Mécanique (curette, pince, compresses) si indiqué et formé ;
- Autolytique via hydrogels/hydrocolloïdes pour ramollir les tissus morts ;
- Chirurgicale en contexte spécialisé ;
- Toujours prévoir antalgiques et expliquer le geste au patient. Désinfectants : à utiliser à bon escient (sur indication), privilégier le rinçage au sérum physiologique en routine.
Choisir le pansement selon l’objectif
Pensez « fonction » plutôt que marque :
- Absorption élevée : alginates, hydrofibres, mousses ;
- Contrôle de la charge microbienne : argent, PHMB, iode (cures limitées et réévaluées) ;
- Stimulation de la cicatrisation : hydrocolloïdes, interfaces siliconées pour protéger les berges ;
- Odeurs : pansements au charbon actif ;
- Peau périlésionnelle : barrières cutanées (crèmes filmogènes, sprays) pour prévenir macération/dermite.
Adapter la fréquence des changes à l’exsudat (viser un lit humide non macéré). Réévaluer hebdomadairement l’efficacité (surface, profondeur, qualité tissulaire).
Compression veineuse : le pilier de l’ulcère veineux
Si insuffisance veineuse documentée et IPS ≥ 0,8, la compression (bandes multicouches, bas classe II/III) accélère la cicatrisation et réduit les récidives.
Points clés :
- Mesurer le mollet/cheville, enseigner la pose (ou organiser l’aide) ;
- Sur veino-artériel (IPS 0,5–0,8) : compression prudente et avis vasculaire ;
- Sur artériel franc (IPS < 0,5) : contre-indiquée.
Offloading et prévention des pressions (pied diabétique, escarre)
- Décharge ciblée : semelles, chaussures thérapeutiques, orthèses ;
- Repositionnement et supports d’aide (matelas/assises) pour répartir les pressions ;
- Contrôle de l’hyperkératose et coupe d’ongles par podologue si besoin.
Escalade de soins et thérapies avancées
En cas de stagnation > 4 semaines malgré bonne prise en charge :
- TPN (thérapie par pression négative) sur indication ;
- Substituts dermiques / greffes en équipe spécialisée ;
- Recherche et gestion du biofilm (cures antimicrobiennes, détersions répétées, réorganisation du protocole).
Organiser la prise en charge : coordination, suivi et éducation
Traçabilité et indicateurs
Documenter à chaque soin : dimensions (L×l×P), type tissulaire, exsudat, photo datée (avec accord), douleur (repos/soin). Suivre un tableau d’évolution : réduction de surface ≥ 20–40 % à 4 semaines = trajectoire favorable.
Protocoles et coordination ville–hôpital
- Ordonnance claire : type de pansement, fréquence, compression, antalgiques, examens (ITB/IPS), consultations (angiologie, diabéto, plaies-et-cicatrisation).
- Rôles : IDE (soins, éducation, alerte), médecin traitant (coordination médicale), spécialistes (revascularisation, offloading avancé).
- Signes d’alerte : douleur croissante, odeur fétide, fièvre, cellulite, nécrose qui s’étend, gangrène → avis urgent.
Éducation thérapeutique : clé de l’adhérence
- Hygiène : douche autorisée si protocole compatible, bien sécher sans frotter ;
- Compression : la porter toute la journée, surélever les jambes quand possible ;
- Décharge : respecter strictement les consignes (pied diabétique) ;
- Chaussage : large, sans couture interne, semelles adaptées ;
- Mode de vie : arrêt du tabac, marche adaptée (si non contre-indiquée), nutrition suffisante en protéines, hydratation.
Prévenir les récidives
- Ulcère veineux : compression au long cours, entretien cutané, contrôle du poids, activité régulière.
- Pied diabétique : auto-inspection quotidienne, soins de pieds, suivi podologique, renouvellement du chaussage.
- Escarre : gestion des appuis et des transferts, évaluation du risque (Braden, Norton), plan de repositionnements.
L’essentiel pour votre pratique quotidienne
Check-list en 6 points :
- Appliquer TIME à chaque évaluation.
- Traiter la douleur avant tout geste.
- Adapter le pansement à l’exsudat et protéger les berges.
- Prescrire/mettre en place la compression si veineux (selon IPS).
- Organiser la décharge et la prévention des pressions.
- Tracer l’évolution avec mesures et photos, et réévaluer à 4 semaines.
Deux actions dès la prochaine tournée :
- Standardiser vos comptes rendus avec un gabarit TIME (dimensions, tissus, exsudat, douleur, berges).
- Ajuster vos pansements en visant un milieu humide contrôlé et une peau périlésionnelle protégée.
Garder le cap dans la durée : fixez des indicateurs simples (surface, douleur, nombre de changes/semaine, tolérance à la compression). Si la plaie stagne ou régresse, revoyez l’étiologie, cherchez un biofilm, sollicitez l’équipe spécialisée et réévaluez les facteurs généraux (glycémie, nutrition, vascularisation).