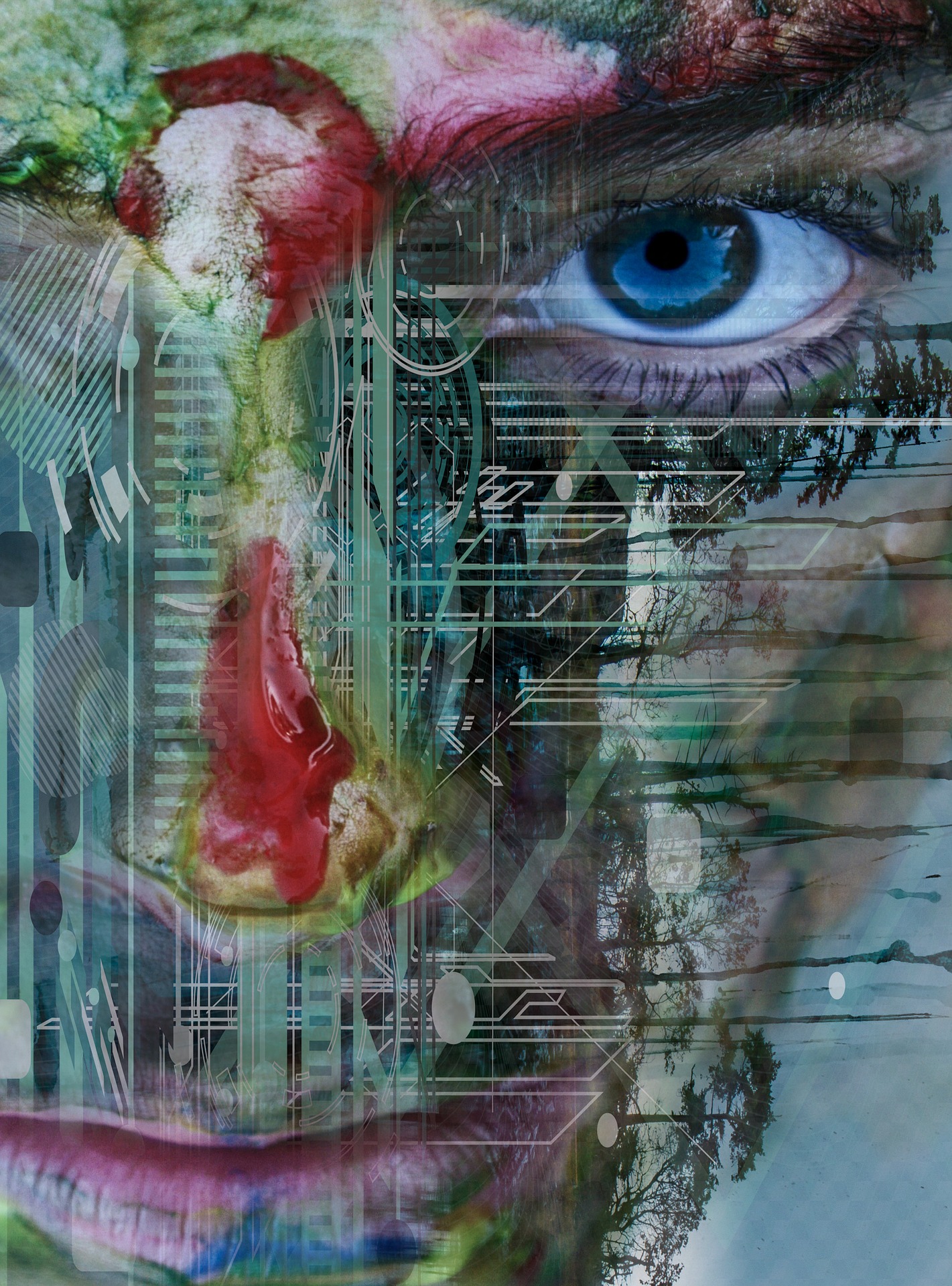La semaine de la schizophrénie (13 au 20 mars) est une semaine de communication visant à démystifier la maladie, faire tomber les tabous et déstigmatiser les psychoses. A cette occasion, nous avons rencontré Nicolas Franck, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier, à Lyon. En plus d’avoir écrit ou coécrit plus de 200 articles sur cette maladie complexe, il est également responsable d’une équipe de recherche travaillant sur la schizophrénie, à l’Institut des sciences cognitives du CNRS.
Lutter contre la stigmatisation
Pour Nicolas Franck, “il est très important de lutter contre la stigmatisation et d’expliquer que la maladie n’est pas une anomalie, c’est juste une différence. La stigmatisation nuit à l’accueil qu’il réserve à la personne et à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Contrairement aux stéréotypes établis, les schizophrènes sont plus dangereux pour elles-mêmes que pour les autres. Il faut travailler sur l’image de la schizophrénie pour pouvoir s’en détacher ou en montrer une image positive. Cela commence par adapter son vocabulaire”.
Plusieurs dimensions symptomatiques
La schizophrénie a trois dimensions symptomatiques de la maladie : positive, négative et la désorganisation. En effet, la forme positive se détecte lorsqu’une personne délire et hallucine. Le plus fréquent est l’hallucination verbale, bien qu’elle ne touche que 30 à 80 % des personnes schizophrènes. En réalité, il n’y a pas de critère consensuel, et c’est loin d’être systématique à chaque patient. Deux personnes avec le même diagnostic n’ont pas forcément les mêmes symptômes, explique-t-il. La dimension négative surgit lorsqu’une personne perd sa volonté d’agir, et ne parvient pas à ressentir des émotions ou du plaisir. La dimension désorganisée signifie l’incapacité à tenir un discours censé.
La schizophrénie survient généralement entre 15 et 25 ans
Bien qu’une personne puisse naître avec des fragilités, la schizophrénie n’est pas totalement génétique, et survient généralement entre 15 et 25 ans. Cette maladie qui touche aussi bien les femmes que les hommes peut se manifester avec un surcroît de stress (traumatisme crânien, choc émotionnel…) ou la consommation de cannabis, qui augmente le risque de déclencher la maladie à un moment donné de sa vie.

“Si la personne délire, cela ne sert à rien de lui asséner brutalement que c’est faux et qu’il est en train de délirer car il ne pourra pas en avoir conscience. L’important est de créer un lien de confiance en se basant sur ses besoins, ses souhaits, et non pas sur des vérités absolues”, rappelle le spécialiste.
La maladie peut être brutale ou progressive
L’arrivée de la maladie peut s’exprimer brutalement avec un épisode psychotique aigu (délire et hallucination d’emblée) qui ne cède pas complètement aux traitements médicamenteux. L’autre cas de figure est l’entrée plus progressive vers la maladie, où il est plus difficile de diagnostiquer la maladie, d’où la nécessité de développer des structures et des offres de soins spécifiques pour les épisodes psychotiques.
Toujours viser le rétablissement
La schizophrénie est très hétérogène car il y a des schizophrènes qui évoluent d’un seul tenant, tandis que d’autres, par poussées. On ne peut donc pas résumer la schizophrénie à un titre évolutif précis. “On ne vise pas guérison car on ne connaît pas les causes et mécanismes, on vise plutôt le rétablissement qui est subjectif. Il y a également la rémission où certaines manifestations de la maladie sont suspendues, mais quoi qu’il en soit, l’objectif primordial est que le patient se sente bien”.
Plusieurs soins sont nécessaires
Les soins combinent plusieurs méthodes, qu’elles soient médicamenteuses ou non-médicamenteuses. En général, le patient a besoin d’un antipsychotique pour éviter que les symptômes positifs soient trop importants et lui fassent souffrir. La personne bénéficiera de la psychoéducation pour qu’elle s’approprie des éléments concernant sa maladie et de son traitement. Elle aura également besoin d’entraînement pour les compétences sociales dans le but d’améliorer sa
communication avec autrui. En outre, la remédiation cognitive peut être utile, en plus d’un travail assidu sur l’autostigmatisation avec des thérapies narratives ou d’autres formes de psychothérapies.
Ecrit pour vous par Raphael Delaprée